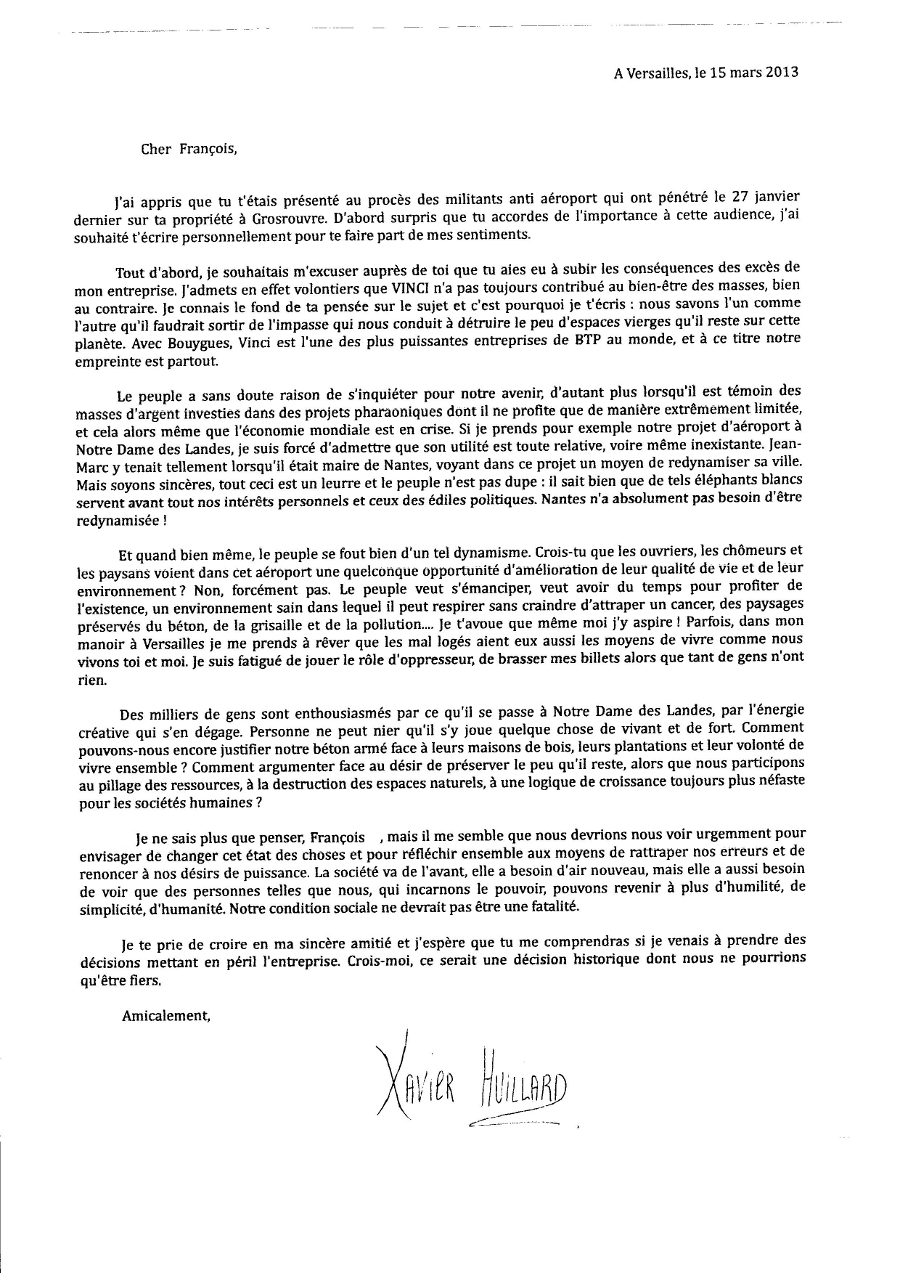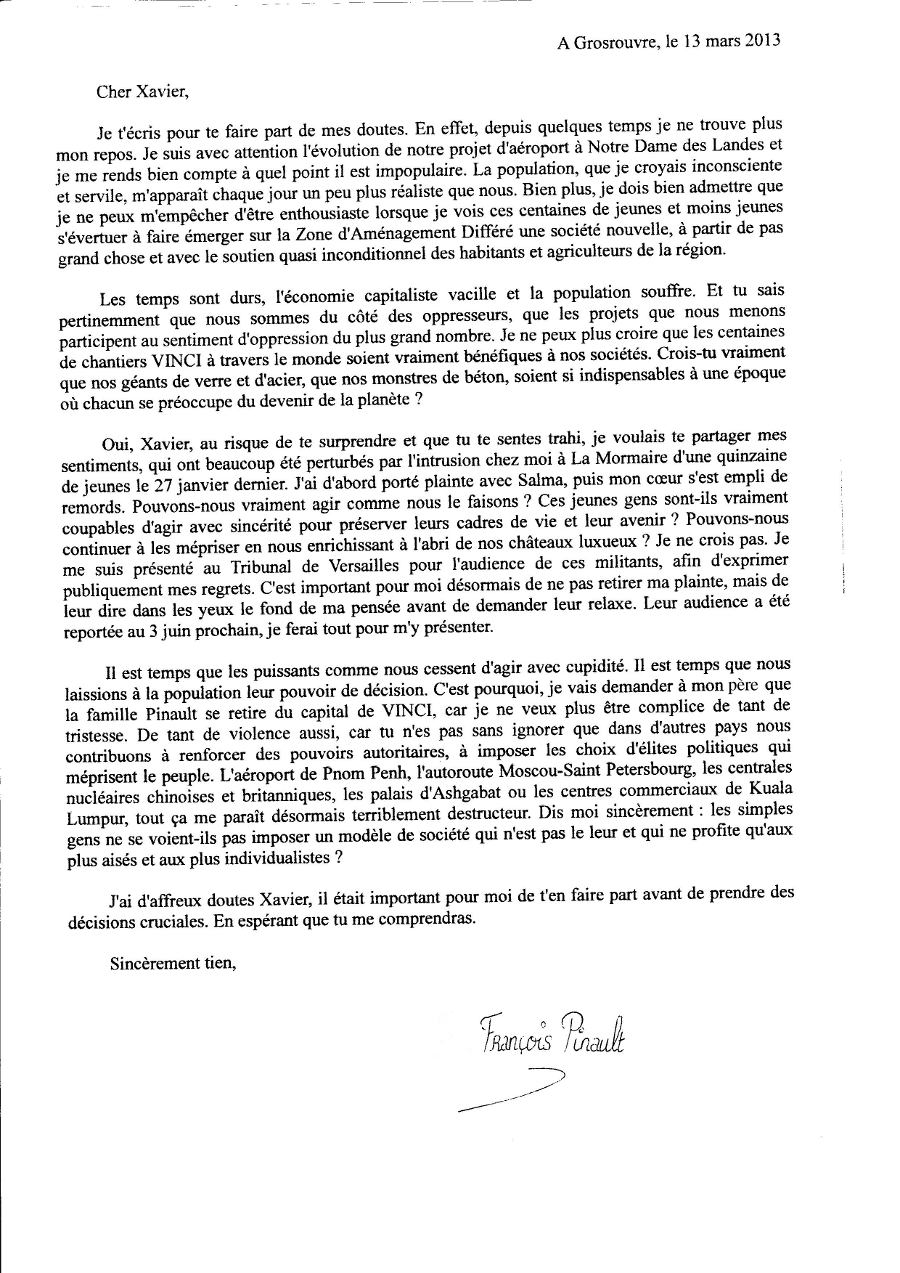Mali : refuser la géopolitique du « moindre mal ». Les objectifs de Serval
Le 10 janvier dernier, l’armée française envoyait un corps expéditionnaire au Mali sous
le prétexte de conjurer la percée annoncée d’une colonne de pick-up djihadiste sur la ville charnière de Mopti (à 640 km au nord de Bamako). L’émotion provoquée par les exactions de ces groupes au
Nord-Mali donnait à cette opération unilatérale les allures d’une croisade humanitaire, soutenue par une bonne partie de l’opinion publique internationale et malienne. Sa base légale restait
cependant très faible, compte tenu de l’illégitimité du pouvoir de Bamako qui l’a ratifiée, mais aussi de la position subordonnée de l’armée malienne et du peu d’empressement des troupes de la
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à lui prêter main forte. Cette réflexion vise à mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette opération néocoloniale, que notre
bimensuel a condamné dès le début, contre les tenants de gauche d’une géopolitique du « moindre mal ».

Soldats français dans une rue de Tombouctou, le 31 janvier dernier
Pour appréhender un phénomène aussi complexe que le soulèvement touareg au Nord-Mali, de même que l’essor de l’islam politique et le rôle joué par les groupe djihadistes armés dans cette région, il
importe de prendre de la distance par rapport aux compte-rendu émotionnels de la grande presse, qui réduit chaque événement à son apparence immédiate, contribuant à le rendre proprement
insaisissable. Je commencerai donc par brosser un tableau social du Mali, dominé par la misère, de larges poches de famine, et la montée des inégalités sociales et régionales, dans un contexte
marqué par la libéralisation économique et l’ouverture aux capitaux étrangers, sous la pression d’une succession de plans d’ajustement structurel, depuis la seconde moitié des années 1980. Ensuite,
je reviendrai sur l’histoire des soulèvements touaregs, de la résistance à la colonisation française à la lutte contre les politiques centralisatrices et répressives du Mali indépendant. Enfin, je
tenterai d’analyser le jeu spécifique de certains acteurs comme les investisseurs internationaux, les djihadistes étrangers et les trafiquants du Sahel. Je conclurai ce tour d’horizon en justifiant
le refus de tout soutien à l’intervention militaire française.
Misère, inégalités et famines
En 2011, le PNUD classait le Mali en 175e position sur 187 pays en termes de développement humain. Les données les plus récentes indiquent que les femmes donnent naissance en moyenne à 6,5 enfants
vivants, dont un sur 6 décède avant l’âge de 5 ans (la moitié de ceux qui survivent souffrent d’un retard de croissance) ; la mortalité maternelle concerne un accouchement sur 200 ; neuf ménages
sur 10 ne disposent pas de l’électricité, 19 sur 20 ne jouissent d’aucun système d’évacuation des eaux usées [Rapport de février 2006 sur la pauvreté au Mali (2001) du gouvernement malien et du PNUD] ;
les trois quarts des Malien-nes de plus de 7 ans n’ont reçu aucune instruction scolaire, etc. Et si les institutions internationales veulent faire état de quelques progrès au cours de cette
dernière décennie, elles concèdent qu’ils se heurtent à une croissance ininterrompue des inégalités sociales – et régionales (les ménages de Gao, de Tombouctou ou de Kidal, dans le nord, dépensent
moins de la moitié de ceux de Bamako) – et du nombre absolu de pauvres.
Pour les populations rurales, affectées par des disettes récurrentes, le « manque de nourriture » est perçu aujourd’hui comme le problème n° 1. Ainsi, au printemps dernier, 13 à 15 millions de
Sahélien-nes étaient frappés par la faim, dont 3,5 à 4 millions de Malien-nes [Fred
Lauener (Caritas-Suisse), « Sahel : Les prix grimpent, la pluie manque et la famine s’installe », 28 mars 2012 (cath.ch)]. Curieux destin pour les descendante-s d’un grand empire africain du Moyen-Âge, que les Peuls avaient surnommés « Mali » – qui signifie «
porter chance ». Il est vrai qu’entre-temps, ses habitant-e-s ont subi l’intensification brutale de la traite négrière au profit des économies atlantiques euro-américaines, puis la colonisation
française, dont les méthodes terroristes méritent d’être rappelées. Vigné d’Octon a ainsi laissé ce récit de la prise de Sikasso (au sud-est de Bamako) : « Tout est pris ou tué. Tous les captifs,
4000 environ, rassemblés en troupeau. […] Chaque Européen a reçu une femme de son choix […] On fait au retour des étapes de 40 kilomètres avec ces captifs. Les enfants et tous ceux qui sont
fatigués sont tués à coups de crosse et de baïonnettes » [Cité par Jean
Suret-Canale, L’Afrique noire, t. 1, Paris, Éditions sociales, 1964].
Sur ces territoires, la mort omniprésente n’est pas que le fait de la conquête, elle imprègne le quotidien des « indigènes » au gré de la spoliation des terres, du travail forcé, des châtiments
corporels, du viol des femmes, de la réduction des cultures vivrières au profit des monocultures d’exportation (le coton au Mali), de la ponction fiscale asphyxiante (en numéraire, dès 1908), des
innombrables humiliations… Franz Fanon en a dressé ce portrait : « le colonisé, pareil en cela aux hommes des pays sous-développés ou aux déshérités de toutes les régions du monde, perçoit la vie
non comme épanouissement ou développement d’une fécondité essentielle, mais comme lutte permanente contre une mort atmosphérique. Cette mort à bout touchant, est matérialisée par la famine
endémique, le chômage, la morbidité importante, le complexe d’infériorité et l’absence de portes sur l’avenir » [« Médecine et colonialisme », in : Sociologie d’une révolution. L’An V de la révolution
algérienne, Paris, Maspero, 1972].
Après les indépendances, très contrôlées par l’ancienne métropole, qui peut compter sur la collaboration des élites locales [Le futur président ivoirien Houphouët-Boigny qui semble avoir utilisé pour la première fois le
terme « Françafrique », auquel il donnait une connotation positive], cet héritage conduira à de nouvelles famines, et ceci dès la fin des années 60 [Sur les mécanismes de base hérités de la colonisation, voir : Comité information
Sahel, Qui se nourrit de la famine en Afrique ?, Paris, Maspero, 1974].
De 1960 à 1968, le Mali indépendant de Modibo Keïta avait usé d’une phraséologie développementaliste, mais sans rompre avec les grandes lignes du compromis néocolonial. Samir Amin a d’ailleurs bien
montré, il y a quarante ans, la vacuité de cette expérience, qu’il n’hésitait pas à traiter de « farce ». Sa banqueroute, marquée notamment par le retour dans la zone franc, précédera d’un an et
demi le coup d’État militaire de Moussa Traoré et l’installation d’une dictature policière qui va durer 23 ans, dès novembre 1968 [L’Afrique de l’Ouest bloquée, Paris, Minuit, 1973. Rétrospectivement, dans son plaidoyer actuel en faveur de l’intervention
militaire française, il donne une appréciation plus positive de l’expérience de Modibo Keïta, évoquant même « des avancées en faveur du progrès économique et social [du Mali] comme de son
affirmation indépendante et de l’unité de ses composantes ethniques » (23 janvier 2013).].
Cette dernière sera renversée en mars 1991, suite à d’importantes mobilisations syndicales (dès janvier), puis de la jeunesse, dont la répression fera plusieurs centaines de morts. Ce mouvement
populaire donnera d’abord le pouvoir à un secteur dissident de l’armée, dirigé par Amadou Toumani Touré, qui le remettra immédiatement aux civils. Pourtant, la nouvelle administration du président
Alpha Oumar Konaré, portée à la tête de l’État par un mouvement social protestataire, va être amenée à poursuivre la même politique de réduction des dépenses publiques, de privatisation des
ressources et d’augmentation des recettes d’exportation. La dette extérieure héritée de la dictature permet en effet à la France, au FMI et à la Banque africaine de développement, d’imposer à
Bamako la poursuite d’ajustements structurels socialement régressifs, que l’on va bientôt renommer sans rire « cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté » [Howard W. French témoigne de ce sabotage de l’expérience démocratique malienne dans A
Continent for the Taking. The Tragedy and Hope of Africa, New York, Vintage Books,
2004].
Les Touaregs : une rébellion sans fin
Les Touaregs sont peut-être 2,0-2,5 millions à peupler le Sahara central et les bordures du Sahel. Ils vivent majoritairement au Niger et au Mali, et de façon plus marginale au Burkina Faso, en
Algérie et en Libye. Ils parlent une langue berbère et s’apparentent aux populations de l’Afrique du Nord avant la conquête arabe. Leur sédentarisation, leur paupérisation, leur fixation dans les
quartiers les plus misérables des villes, mais aussi leur acculturation, sont des tendances générales à l’échelle régionale, favorisant la formation d’un foyer de révolte endémique dans les vastes
territoires qui séparent le Maghreb de la Françafrique. En réalité, le fait touareg est en lui même un révélateur de l’architecture politique arbitraire de l’Afrique occidentale postcoloniale, dont
atteste notamment le tracé des frontières entre États.
Au Mali, plus spécifiquement, il est extrêmement difficile de mesurer le poids démographique de ce peuple. Selon les sources les plus crédibles, ils seraient 500’000 à 800’000, soit 3 à 5% des 16
millions de d’habitant-e-s de cet État. Dans les trois régions du Nord, ils représenteraient cependant un tiers et peut-être la moitié d’une population estimée à moins de 1,5 million d’âmes.
Cependant, contrairement aux autres habitant-e-s du pays, dont les couches les plus défavorisées se concentrent dans les zones rurales, les Touaregs les plus pauvres vivent en ville, notamment à
Tombouctou, Gao ou Kidal, mais aussi à Bamako. Cette particularité pourrait contribuer à expliquer l’influence croissante parmi eux de groupes politiques salafistes, comme Ansar Dine, qui ont su
tirer parti des ressentiments provoqués par un tel « déclassement ».
Depuis la fin du 19e siècle, les Touaregs offrent une résistance farouche à la France. En janvier 1895, ils infligent une défaite cuisante au colonel Bonnier, qui trouve la mort devant Tombouctou
avec son état-major, avant que le colonel Joffre ne reprenne l’offensive coloniale avec succès. Petit à petit, les métropolitains « parviennent » à occuper l’Azawad, brisant tout foyer de
résistance au moyen de représailles sanguinaires. Dès 1903, ils soumettent la principale confédération de tribus, avant qu’elle ne reprenne le flambeau de la révolte au cours de la Première Guerre
mondiale (1916-1917). Cet ultime soulèvement généralisé est sanctionné par un véritable massacre. Dès lors, toute insubordination est cruellement réprimée. En 1954, le régime colonial promène ainsi
la tête d’Alla ag Albacher dans les rues de Boureissa pour montrer le sort qu’il réserve à ceux qui osent s’opposer à l’autorité française.
Au lendemain de l’indépendance, la révolte touarègue fait cependant rage à nouveau, en 1962-1964. Elle sera brutalement écrasée par le pouvoir centralisateur de Modibo Keïta, qui n’hésite pas à
commander le bombardement des populations civiles de l’Adrar des Iforas et le mitraillage de leur cheptel, obligeant même leurs enfants à chanter en bambara.
Les hostilités reprendront de 1990 à 1995 (on parle de 5000 victimes), suscitant une nouvelle vague de répression, mais aussi l’explosion de conflits inter-ethniques et la formation de milices
d’auto-défense parmi les Songhaïs. Pourtant, cette nouvelle éruption n’est pas comparable à celle des années 60, dans la mesure où elle implique bon nombre de rapatriés de Libye et d’Algérie, qui
s’étaient enrôlés dans la Légion islamique de Kadhafi (dissoute en 1987) ou dans le Front Polisario, poussés par les famines des années 70 et 80. De retour au pays, ils ont recruté des jeunes sans
emploi et formé des groupes mobiles, équipés de 4 × 4 et d’armes légères, pour harceler des symboles de l’État central ou des sites stratégiques (mines d’uranium d’Arlit au Niger). Pourtant,
faute d’enracinement social et de ciment idéologique, ils ne parviennent pas à surmonter leurs divisions tribales et régionales. En 1996, ils finissent par accepter de déposer les armes en échange
d’un plan de réinsertion de leurs combattants et du retrait de l’armée du Nord-Mali. Ce résultat politique sera conforté socialement par un recul provisoire de la sécheresse et une hausse des prix
du bétail.
Arguant du non respect de ces accords, le soulèvement touareg reprend cependant en 2006-2008, provisoirement endigué par un effort de médiation algérienne. Il coïncide avec une nouvelle
exacerbation des inégalités sociales et régionales. Des développements analogues se produisent d’ailleurs au Niger, en 2007-2009, marqués par l’enlèvement de quatre employés de l’entreprise
française Areva (juin 2008), libérés quelques semaines plus tard. Ils se concluront par la médiation de la Libye, alors très proche de Paris… Les hostilités reprendront au Nord-Mali en janvier
2012, à la faveur d’une terrible sécheresse, mais aussi d’un nouvel afflux d’armes et de mercenaires, mis sur la touche suite à l’effondrement du régime de Kadhafi. Si les combattants touaregs ont
pu d’abord paraître moins divisés entre eux que dans les années 90, avec la formation, du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), c’était sans compter sur les succès du front salafiste
Ansar Dine (Défenseurs de la religion), mené par Iyad ag Ghali, l’un des principaux chefs du soulèvement des années 90. À noter que l’homogénéité même de ces deux forces est faible, comme l’ont
montré la relative dilution du MNLA et la scission plus récente d’Ansar Dine.
Course aux ressources naturelles
Les capitaux étrangers s’intéressent de plus en plus à l’Afrique subsaharienne qui, loin d’être un sous-continent délaissé par la mondialisation, suscite un intérêt croissant dans les domaines
agricole, minier et énergétique. Au Mali, le Conseil présidentiel pour l’investissement (CPI), fondé en 2003, comprend des représentants de nombreuses multinationales – Anglogold, Barclays,
Coca-Cola, etc. –, et associe le FMI et la Banque mondiale à ses réunions. Par ailleurs, l’Agence malienne de promotion des investissements (API), créée en 2005, note que les flux des capitaux
étrangers sont encouragés sans restriction (y compris le rapatriement des dividendes et des produits des ventes et liquidations). Dans le domaine foncier, l’API affirme que 2,5 millions d’hectares
de terres arables sont disponibles aux investisseurs [En particulier sur les terres
irriguées de l’Office du Niger, un héritage de la colonisation], en grande majorité étrangers, notamment pour produire des agro-carburants, alors que le pays n’en compte en tout que 4,7
millions, et que la surexploitation des sols conduit à leur dégradation et désertification accélérées [The Oakland Institute, Comprendre les investissements fonciers en Afrique. Rapport :
Mali, 2011 (oaklandinstitute.org)].
Dans le domaine minier, le sous-sol du Mali contient beaucoup plus de ressources que celles mises en exploitation. Sa production d’or fait la fortune de l’Anglogold sud-africaine et place le pays
en 16e position mondiale (2009). Pourtant, les conditions de travail y sont déplorables (en particulier pour les enfants de moins de 15 ans) et les risques qu’elle fait courir à l’environnement ne
justifient en aucun cas ses retombées économiques, qui servent pour l’essentiel à assurer les revenus de quelques rentiers locaux (20% du capital sont en mains maliennes), de même que le service de
la dette extérieure. L’exploitation d’autres gisements – pierres semi-précieuses, bauxite, uranium, etc. – sont encore largement du domaine de la prospective.
De gros espoirs portent sur l’extraction futur du pétrole dans le nord du pays, en particulier dans le basin de Taoudeni, mais le forage, l’exploitation et le transport des hydrocarbures posent
encore des problèmes techniques, logistiques et financiers insolubles, sans parler des questions de sécurité. Si des intérêts énergétiques sont directement impliqués dans l’intervention militaire
française au Mali, ce sont ceux liés à l’exploitation des gisements d’uranium d’Arlit au Niger (4e producteur mondial) par la société Areva, à 300 km à l’est de la frontière de la région malienne
de Kidal. On rappellera que plus du tiers du combustible consommé par les centrales nucléaires hexagonales viennent de ce pays, et qu’Areva vient de signer un accord pour l’exploitation du bassin
d’Imouraren (2e réserve au monde), à 80 km au sud d’Arlit, dont elle détient près de 60% du capital, et où une première tranche d’investissements de 1,2 milliard d’euros est déjà programmée.
Djihadistes et trafiquants
La situation sur le terrain est compliquée par la montée en puissance de deux types d’acteurs, qui se confondent largement, tout en se disputant l’espace du Sahel : 1. Les djihadistes étrangers
issus du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) – dissidence du Groupe islamiste armé algérien (GIA) – qui se revendiquent d’al-Qaïda, dont une fraction rivale, le Mouvement pour
l’unité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) s’intéresse plus spécifiquement à l’Afrique subsaharienne ; 2. Les trafiquants en tous genres, en particulier de cocaïne et d’héroïne, et leurs
relais locaux. Évidemment, les sources de financement et les complicités politiques de ces deux types d’acteurs sont beaucoup plus importantes et plus diversifiées que celles dont disposent les
rebelles touaregs.
1. L’essor des groupes djihadistes au Sahel résulte de leur double défaite, en Afghanistan et en Algérie, mais aussi de leur affaiblissement relatif au Pakistan. Al-Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI) est ainsi réputé depuis quelques années avoir établi le nouveau centre mondial de ses activités terroristes dans les pays africains, entre le 12e et le 20e degré de latitude nord, du Soudan
à la Mauritanie. Les forces se revendiquant d’AQMI, dont il est difficile de mesurer les effectifs, se sont formées dans le prolongement de l’annulation de la victoire électorale du Front islamique
du salut (FIS) par l’armée algérienne, en 1992, qui précède la répression implacable du Groupe islamique armé (GIA), dont une dissidence cherchera à sortir du cas-de-sac algérien en fondant le
Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), en 1998, qui se lie au djihadisme international dans la première moitié des années 2000, avant de prendre le nom d’AQMI en 2007.
Bien malin qui peut évaluer aujourd’hui les effectifs et le fonctionnement de cette nébuleuse éclatée, tiraillée par divers parrains occultes, mais aussi au gré de divers trafics lucratifs, dont
les prises d’otages et demandes de rançon [Un nombre croissant d’observateurs doutent de
l’existence d’une structure centralisée répondant au sigle AQMI (voir notamment Mehdi Tage, « Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel »,Enjeux ouest-africains, n° 1, août 2010)]. Il est cependant raisonnable de la distinguer d’un islam politique
d’obédience salafiste, disposant d’une certaine implantation populaire, comme Ansar Dine au Nord-Mali. Ce dernier tente plutôt d’exploiter à son profit la paupérisation endémique, accentuée par les
traitements de choc des institutions financières internationales – soutenues par les puissances occidentales –, mis en œuvre par les autorités néocoloniales de Bamako. Il vise ainsi à élargir son
audience pour établir un nouveau régime fondé sur son interprétation de la charia.
C’est en invoquant la menace du terrorisme, que les États-Unis ont décidé d’accroître leur intervention militaire en Afrique, mettant sur pied en 2007 un nouveau commandement continental (Africom).
Celui-ci multiplie les efforts de collaboration – exercices communs, formation de cadres, etc. – avec les armées africaines, notamment au Mali, dans le cadre du « Partenariat transsaharien contre
le terrorisme ». En réalité, ce déploiement renforcé vise plus fondamentalement à sécuriser les approvisionnements US en pétrole (et autres matières premières) par le Golfe de Guinée, et à se
positionner plus fortement pour faire face à la compétition croissante de la Chine.
2. L’importance des trafics actuels de drogue (cocaïne et héroïne) et de cigarettes de contrefaçon, mais aussi d’immigrant-e-s clandestins transitant par le Sahel vers l’Afrique du Nord et
l’Europe, reste l’objet de conjectures, même s’il semble établi qu’ils ont connu une progression au cours de ces dernières années. Ainsi, en novembre 2009, un vieux boeing 727 modèle cargo – l’un
des seuls gros jets à pouvoir atterrir sur des pistes sommairement aménagées – a été découvert dans le désert malien, à 200 km au nord de Gao. En provenance d’Amérique du Sud, il devait
approvisionner en cocaïne les marchés français (via l’Algérie) et espagnol (via le Maroc).
Les groupes djihadistes se financent grâce aux enlèvements d’otages et aux nombreux trafics auxquels ils s’adonnent, qui stimulent en retour celui des armes. C’est ainsi que Mokhtar Belmokhtar,
planificateur présumé de la prise d’otages d’In Amenas en Algérie, était aussi connu sous le surnom de « Mr Marlboro ». Dans de telles conditions, plus d’un observateur – de Tariq Ramadan aux
porte-paroles de l’armée française – a pu mettre en doute les objectifs religieux de ces groupes. Pour ma part, je ne vois pas au nom de quoi il faudrait opposer la foi à l’appât du gain et à la
terreur, même s’il est évident que le salafisme à vocation populaire est régi par d’autres dynamiques sociales que le djihadisme d’Al-Qaïda.
Un tel imbroglio a favorisé récemment l’essor de nombreuses théories du complot, qui croient deviner derrière la multiplication des groupes islamistes armés au Sahel, mais aussi des trafics de tous
genres, la promotion des intérêts des États-Unis, voire de l’Allemagne, qui rêveraient de la formation d’un émirat sahélien indépendant, riche en matière premières et docile, séparé des États
françafricains du Mali et du Niger. C’est ainsi au nom du « moindre mal » présumé de la domination française sur l’ensemble de cette région, que Samir Amin a justifié, le 23 janvier dernier, à la
surprise de nombre de ses partisans, son soutien à l’opération Serval au Mali [On pourra
lire la prise de position de Samir Amin, et sa critique pertinente par Paul Martial, sur le site Europe-solidaire.org. Voir Samir Amin (article 27717), Débat sur l’intervention française au Mali : le point de vue de Samir Aminet Paul Martial (article
27718), Débat : sur le soutien de Samir Amin à l’intervention française au Mali].
Les véritables objectifs de Serval
Moins de quatre semaines après le début de l’intervention militaire hexagonale, son succès paraît complet : la prise des principales villes du Nord a été rapide et un seul militaire français y a
trouvé la mort ; les pertes civiles et les destructions au sol restent inconnues, vu le black-out médiatique imposé par Paris ; les djihadistes se sont évaporés, fuyant semble-t-il les combats ;
les responsables maliens ont accueilli les troupes de l’ancienne métropole en libératrices avec un soutien populaire indiscutable ; les représailles perpétrées par l’armée maliennes ou les milices
d’auto-défense communautaires n’ont pas réussi à entacher le succès de Paris, dont le moindre des miracles n’est pas d’avoir conféré à François Hollande une stature quasi-gaullienne –
selon Le Parisien, l’Opération Serval est approuvée par 75% des sondé-e-s.
Le succès apparent de cette guerre éclair pose cependant une question : n’avait-on pas à dessein surestimé la puissance de feu de ces djihadistes « aguerris » et « lourdement armés », qui ont pris
la fuite devant quelque 2000 soldats français [Le 13 janvier, Philippe Duval montrait
déjà que le péril islamiste avait été grossièrement surestimé (tamoudre.org)] ? Paris ne s’est-il pas payé le luxe de tenir l’armée malienne totalement à l’écart des engagements les plus délicats, comme la
prise de Kidal, investie sans combats ? Comment dès lors accréditer l’idée que ces combattants islamistes étaient sur le point de foncer sur la ville charnière de Mopti, au centre du pays, pour
s’emparer de Bamako, une capitale de 2 millions d’habitant-e-s qui leur est violemment hostile ? Si le pouvoir malien était réputé incapable d’une telle riposte, c’est qu’il ne disposait donc
d’aucun soutien populaire, et qu’il aurait fallu en changer. Or, la France, déjà défiée par le putsch avorté du capitaine Sanogo, en mars 2012, ne disposait dans l’immédiat d’aucune carte de
rechange. Son engagement, préparé sur le terrain par l’Opération Sabre [Depuis deux ans,
la France avait déployé des forces spéciales, des hélicoptères et un arsenal significatif au Burkina Faso et en Mauritanie, dispositif renforcé en septembre dernier dans le cadre de l’Opération
Sabre], dès le mois de septembre, va lui laisser le temps de préparer une « alternative démocratique », sanctionnée par des élections en bonne et due forme.
Ceux qui promettaient un bourbier afghan à Paris et relevaient avantageusement la prudence affichée par Washington et Berlin en seront pour leurs frais. En revanche, les autorités maliennes et
régionales – par le truchement de la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA) – vont devoir payer leur dette en combattant les unités djihadistes repliées dans les sables et les montagnes
de l’Azawad. Des bruits insistants courent aussi quant à l’installation prochaine d’une base française à Mopti : « Ce n’est pas un hasard, note un commentateur sénégalais, si le bâtiment de la
Marine (le porte-hélicoptères Dixmude) a appareillé de la rade de Toulon vers Dakar, avec un chargement aussi volumineux que cinq TGV » [B. J. Ndiaye, « Mali : à quoi sert Serval ? », 2 février 2012 (nettali.net)]. Une telle base, à faible distance des gisements d’uranium d’Arlit, et surtout d’Imuraren, emportés de haute lutte par Areva contre
ses concurrents chinois, compléterait celles de N’Djaména, Abéché (au Tchad) et Djibouti sur la frontière saharo-sahélienne.
En même temps, Paris va sans doute maintenir une force d’intervention lourdement armée à Bamako afin d’assurer une transition politique à ses conditions face aux secteurs rétifs de l’armée
malienne. Il se pourrait d’ailleurs bien qu’elle comporte un degré d’autonomie limité pour les Touaregs, ce qui expliquerait que les unités spéciales chargées d’investir Kidal aient tenu l’armée
malienne à l’écart, et que la DGSE (services secrets), déjà en contact avec le MNLA, ait activement œuvré à scissionner le mouvement salafiste Ansar Dine. Il semble en effet que son porte-parole,
Mohamed Ag Arib, longtemps immigré en France, et connu du Quai d’Orsay, ait joué un rôle clé dans la mise sur pied du tout nouveau Mouvement islamique de l’Azawad (MIA).
La bourgeoisie française a remporté une bataille significative en Afrique de l’Ouest, au moins pour le moment, non seulement aux dépens de ses concurrents occidentaux, mais surtout des peuples
africains, qui vont être exposé à une nouvelle étape de l’agenda néolibéral que Paris soutient sans réserve. Pour y faire face, il est grand temps que la gauche et les mouvements sociaux maliens,
africains et internationaux cessent une fois pour toute de penser en termes de géopolitique du « moindre mal » pour renouer avec une analyse de classe internationaliste.
Jean Batou, Europe solidaire sans frontières, 4 février 2013 – À paraître en « Cahier émancipation » dans le prochain
numéro de solidaritéS (Suisse)