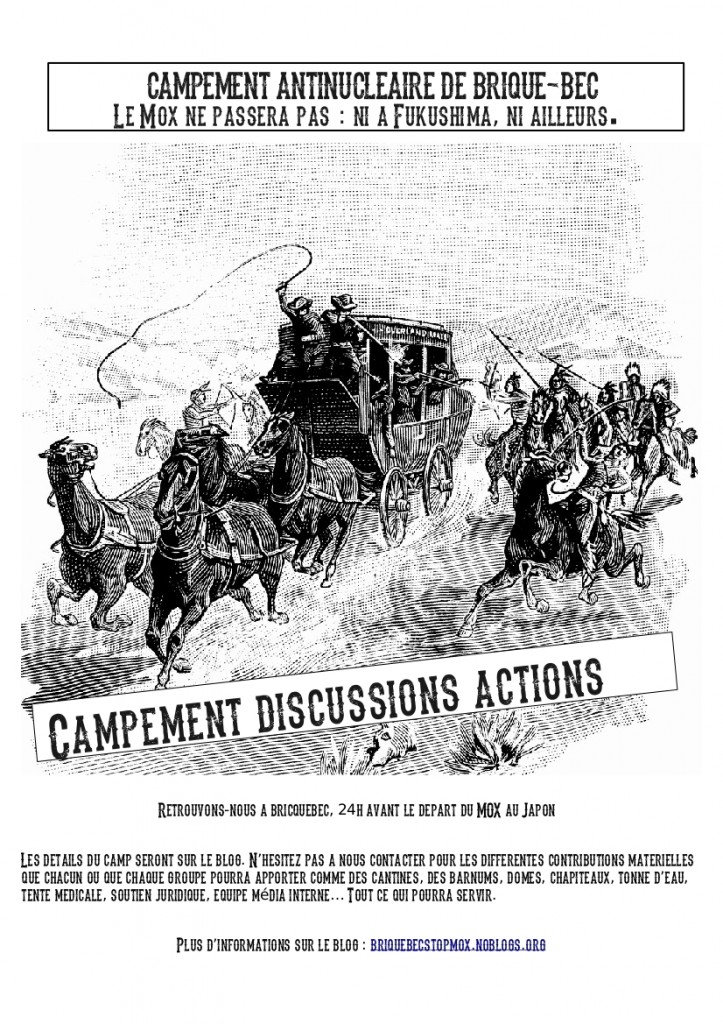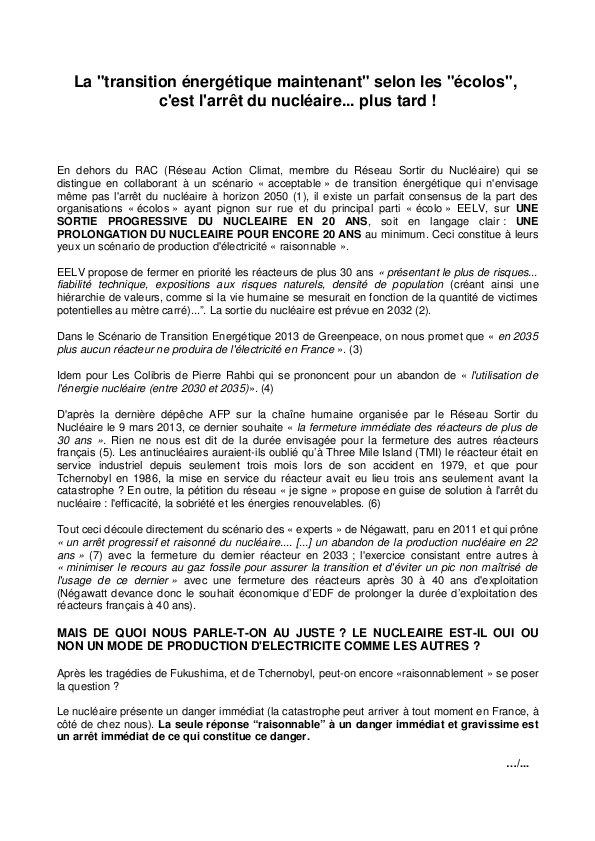Le scandale alimentaire qui s’annonce
Que se passe-t-il vraiment dans l’univers de la viande industrielle ? Et que nous
fait-on manger, de gré ou de force ? Avant d’essayer de répondre, il est bon d’avoir en tête deux études récentes.
La première, publiée en 2011, montre la présence dans le lait — de vache, de chèvre ou d’humain —
d’anti-inflammatoires, de bêtabloquants, d’hormones et bien sûr d’antibiotiques. Le lait de vache contient le plus grand nombre de molécules.
La seconde, qui date de 2012, est encore plus saisissante. Une équipe de chercheurs a mis au point
une technique de détection des résidus dans l’alimentation, en s’appuyant sur la chromatographie et la spectrométrie de masse.
Analysant des petits pots pour bébés contenant de la viande, ils y ont découvert des antibiotiques destinés aux animaux, comme la tilmicosine ou la spiramycine, mais aussi des antiparasitaires,
comme le levamisole, ou encore des fongicides.
Certes à des doses très faibles — en général —, mais, comme on le verra, la question se pose aujourd’hui dans des termes neufs.
On remarquera que, dans le scandale en cours, un mot a presque disparu : phénylbutazone. Cet anti-inflammatoire, on le sait, a été retrouvé dans des carcasses de chevaux exportés vers la France.
UNE FRAUDE ISOLÉE ?
Or la phénylbutazone est un produit dangereux, interdit dans toute viande destinée à la consommation humaine. S’agit-il d’une fraude isolée ? Ou bien, comme certains éléments permettent de
l’envisager, d’une pratique tolérée par les autorités de contrôle ?
Nul besoin d’une vaste enquête pour avoir une idée de l’incroyable pharmacopée destinée aux animaux d’élevage. La liste des produits autorisés contient de nombreux
douvicides (contre des vers parasites), anticoccidiens (parasites de l’intestin), anthelminthiques (vermifuges), hormones, vaccins, neuroleptiques et antibiotiques.
Sait-on comment l’oxytétracycline se mélange avec la gonadolibérine chez un poulet ? Comment le flubendazole se marie avec l’azapérone et les prostaglandines PGF2 dans la chair d’un porc ? Le
thiabendazole avec le diazinon ou le décoquinate dans le sang d’une bonne vache charolaise ?
Aucune étude sur les effets de synergie de ces produits n’est menée. Il n’est pas dit qu’elles seraient possibles.
Lorsque c’est le cas, on découvre en tout cas un nouveau monde. Le 3 août 2012, la revuePloS One publiait un travail sur les effets combinés de trois fongicides très employés
dans l’agriculture. Leur association provoque des effets inattendus sur les cellules de notre système nerveux central.
Commentaire de l’un des auteurs, Claude
Reiss : “Des substances réputées sans effet pour la reproduction humaine, non neurotoxiques et non cancérigènes ont, en combinaison, des effets insoupçonnés.”
Effets insoupçonnés, éventuellement cancérigènes, ouvrant la voie — peut-être — à des maladies neurodégénératives comme Parkinson, la sclérose en plaques ou Alzheimer.
Cette découverte est cohérente avec les grands changements en cours dans la toxicologie, qui étudie les substances toxiques.
“LA DOSE FAIT LE POISON”
Aujourd’hui encore, le principe de base de cette discipline est le Noael (No observed
adverse effect level), ou dose sans effet toxique observable. Longtemps avant Noael, son précurseur Paracelse — un magnifique alchimiste du XVIe siècle — résumait à sa façon le
paradigme actuel de la toxicologie : “Toutes les choses sont poison, et rien n’est sans poison ; seule la dose fait qu’une chose n’est pas un poison.”
Phrase-clé que des générations de toxicologues ont résumée dans cette formule : “La dose fait le poison.”
Mais la connaissance bouscule les idées en apparence les plus solides. Le lourd dossier des perturbateurs endocriniens vient rebattre les cartes de manière spectaculaire.
En deux mots, ces substances chimiques imitent les hormones naturelles et désorientent des fonctions essentielles du corps humain, comme la reproduction ou la différenciation sexuelle.
Or les perturbateurs agissent à des doses si faibles que l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a pu conclure, dans un rapport de 2011, que les effets de l’un d’eux, le bisphénol A,
étaient avérés à “des doses notablement inférieures aux doses de référence utilisées à des fins réglementaires”.
Il est certain que ce seul propos marque un tournant. Car du même coup, la dose journalière admissible (DJA) du bisphénol A — sa limite légale — pourrait être divisée par … 2 millions,
selon le toxicologue André Cicolella.
Le bisphénol A pourrait même “avoir des effets plus importants à très faible niveau d’exposition qu’à haut niveau”, ce qui mettrait à bas tout l’édifice.
Quel rapport avec cette fraude géante appelée désormais “horsegate” ? C’est on ne peut plus limpide : nul ne sait ce que contient réellement la viande industrielle. Et nul ne veut savoir. Dans la
lutte contre l’orgie d’antibiotiques donnés au bétail, le ministère de l’agriculture apparaît comme un Janus biface.
D’un côté, des promesses, et, de l’autre, l’inaction. Il lance fin 2011 un plan de réduction “de 25 % en cinq ans de la consommation des antibiotiques destinés aux animaux”, mais que n’a-t-il œuvré
auparavant ? Entre 1999 et 2009, l’exposition du bétail à ces médicaments a augmenté de 12,5 %.
Certes, le volume global a baissé entre ces deux dates, mais les nouveaux produits sont actifs à des doses plus faibles. La situation s’aggrave, alors que l’antibiorésistance a été repérée dès
avant la seconde guerre mondiale.
De quoi s’agit-il ? Après un temps court, les bactéries combattues par un antibiotique mutent. Ainsi des sulfamides, introduits en 1936, confrontés dès 1940 à des souches résistantes de bactéries.
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Ainsi de la molécule de tétracycline, ainsi du tristement célèbre staphylocoque doré, dont plusieurs souches résistantes ont donné diverses lignées SARM (staphylocoque doré résistant à la
méticilline).
Le SARM joue un rôle fondamental dans les infections nosocomiales, celles qui surviennent dans les hôpitaux. Bien que des chiffres indiscutables n’existent pas, on pense que les trois quarts des
7000 à 10’000 décès annuels de ce type en France sont le fait de bactéries résistantes aux antibiotiques, au tout premier rang desquelles le SARM.
Des chiffres officiels américains font état de 19’000 morts dans ce pays en 2005, soit davantage
que le sida. L’enjeu de santé publique est donc considérable.
Et il n’est pas exagéré de parler d’une maladie émergente, dont l’évolution demeure imprévisible. Tout récemment, le professeur David Coleman, spécialiste de la question, a identifié une
souche si différente des autres qu’elle ne peut être détectée par les tests existants. Bien qu’elle touche les humains, elle se développe tout d’abord chez des animaux d’élevage, surtout les
bovins.
Ce n’est guère étonnant, car une autre souche — le CC398 — prolifère depuis des années dans les élevages industriels.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu, en 2010, un avis indiquant que le réservoir du CC398 se trouve chez les bovins, la volaille, mais surtout chez les porcs.
Fait inquiétant, le SARM animal est de plus en plus présent dans les infections humaines, et une étude néerlandaise (Voss et al., 2005) établit que les producteurs de porcs sont 760 fois plus touchés que la
population générale.
Un exemple frappe l’imagination : celui d’un vétérinaire (Nienhoff et al.,
2009) qui transmet à son propre chien un SARM animal acquis au contact d’un porc.
C’est dans ce contexte de grande inquiétude que l’EFSA lance en 2008 une enquête européenne. Disons franchement qu’elle étonne. Laissons de côté le mystère britannique,
qui ne reconnaît aucun cas de SARM animal.
L’Espagne, en revanche, a retrouvé la souche CC398 dans 46 % des élevages porcins, l’Italie dans 14 % d’entre eux, l’Allemagne dans 43,5 % et la Belgique dans 40 %. Autrement exprimé, tous nos
voisins sont fortement touchés. Mais pas nous.
Nos services ne rapportent que 1,9 % d’élevages porcins frappés par le SARM animal, dont tout le monde sait qu’il tue en France un nombre inconnu, mais en toute hypothèse élevé, de malades.
Ce pourcentage est peut-être exact, mais il fait penser, mutatis mutandis, à ce nuage de Tchernobyl qui aurait par miracle épargné la France.
Il est peut-être exact, mais l’Europe elle-même, par le biais de l’EFSA, a diplomatiquement fait état de sa grande surprise au vu des résultats. Citation du rapport de 2009 : “L’EFSA recommande en
outre que de nouvelles études soient réalisées afin d’identifier les raisons justifiant les différences observées au niveau de la prévalence du SARM dans les différents États membres.”
Oui, pourvu que ce pourcentage soit exact, ce qui serait mieux que de jouer avec le feu bactérien. Car laisser flamber le SARM dans les élevages serait autrement plus grave que le tour de
passe-passe autour de la viande de cheval.
Aucune équipe gouvernementale, depuis cinquante ans, n’a osé ouvrir le dossier infernal de l’élevage industriel et de la folie des antibiotiques. Le moment est peut-être venu.
Fabrice Nicolino
La communication de crise entre en scène
Il n’est pas injurieux de parler de mise en scène. Après tout, chacun évoque depuis
longtemps la “scène médiatique”, et c’est bien là que se joue en partie la crise actuelle de la viande industrielle. Parmi les nombreux acteurs de la pièce, l’agence de communication reste
obstinément dans l’ombre, ce qui empêche de saisir certains des ressorts de l’intrigue. Mais voyons de plus près.
Le 11 février, le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll,
déclare : “Je découvre la complexité des circuits et de ce système de jeux de trading entre grossistes à l’échelle européenne.” Est-ce crédible de la part d’un petit-fils d’agriculteur,
titulaire d’un BTS agricole, longtemps professeur d’économie dans un lycée agricole ? Mais n’était-ce pas le début d’une stratégie de communication, destinée à éteindre l’incendie ? Il faut
comprendre que M. Le Foll s’appuie sur des règles de communication.
Un, il s’agit de désigner un responsable unique, portant un nom et si possible un visage. La recherche d’un bouc émissaire appartient à l’histoire ancienne des sociétés humaines, elle peut paraître
élémentaire, mais c’est précisément sa force. La communauté a besoin de se ressouder au détriment d’un coupable.
FEUILLE DE ROUTE
Preuve s’il en était besoin de ce scénario, on a commencé par accuser la Roumanie, pays lointain, mais, la tentative ayant échoué, on essaya d’incriminer un trader néerlandais, avant que le
ministre de la consommation, Benoît Hamon, ne charge la société française Spanghero.
Premier mouvement de communication : la désignation. Suivie d’une puissante affirmation de la puissance publique, annonçant fièrement qu’elle allait multiplier contrôles et analyses. Pour enfin
imposer une loi nationale à une industrie désormais mondialisée et financiarisée. Ne raillons pas, car nos ministres ne font que suivre une feuille de route, qui est celle d’agences spécialisées.
On ne trahira pas un secret en écrivant que d’excellents professionnels sont chargés d’offrir services et conseils en cas de crise alimentaire. L’une des principales agences parisiennes est
conduite par un ancien responsable de l’association de consommateurs UFC-Que choisir. Ce qui permet sans doute de répondre à la crise avec bien plus d’à-propos.
Ces agences sont évidemment intervenues dans les dossiers les plus chauds de ces vingt dernières années : vache folle, poulet à la dioxine, farines animales, grippe aviaire, grippe porcine. Un
exemple moins connu, mais éclairant, concerne l’affaire des dioxines contenues dans le saumon d’élevage européen, révélée par une étude scientifique parue dans Scienceen janvier 2004. L’agence de communication embauchée par les industriels français du
saumon lance aussitôt une contre-offensive qui se révélera payante. On ne peut la raconter en détail, mais elle passera par une authentique désinformation visant à discréditer l’article
de Science. Illégal ? Non : discutable.
Fabrice Nicolino
Né en 1955 à Paris, Fabrice Nicolino a travaillé comme enquêteur, chroniqueur ou
reporter pour un grand nombre de journaux français, parmi lesquels Géo, Le Canard enchaîné, Politis, Télérama, Terre sauvage, La Croix. Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, dont des livres pour enfants — dernier en date
: Ma tata Thérèse(Sarbacane, 2012) — et des essais comme Pesticides, révélations sur un scandale
français (Fayard, 2011) et Bidoche : l’industrie de la viande menace le
monde (Actes Sud, 2010).
Presse avariée (LeMonde.fr, 25 février 2013)
Minerai de viande : « Avant, on n’osait pas en faire de la bouffe pour chat »
La « viande » de nos plats préparés porte le nom de minerai, « des bouts de machin, de
gras notamment, catégoriquement de la merde. Il y a 40 ans, cette matière allait à l’équarrissage pour être brûlée », nous dit un expert.
Ma mère n’a jamais cuisiné. J’ai passé mon enfance à manger des petites quiches vertes toutes molles et des lasagnes à la bolognaise surgelées.
Le scandale de la viande de cheval 100% pur bœuf a éclaté la semaine dernière, et aucune surprise pour moi : je me doutais bien que ce qu’il y avait dans ma moussaka micro-ondée n’était pas de la
vraie viande, saillante et fraîche.
Ces petits bouts de trucs marrons étaient denses sous la dent et je crois que cela me suffisait. La sauce rouge (je n’ose plus affirmer que c’était de la tomate) faisait passer le tout. Cela ne m’a
jamais empêché de dormir.
Je ne pensais pas qu’on me mettrait un jour face à la triste et dégoûtante réalité : j’ai mangé des centaines de kilos de « minerai de viande » donc de déchets.
C’est un article publié sur Rue89 par Colette
Roos qui m’a appris l’existence de ce mot. Certains de mes proches l’avaient découvert en écoutant France Inter ce week-end et ils sont restés bloqués sur des images de terrils, de
sidérurgie.
En cliquant sur le mot « minerai » – une page Wikipédia a aussi été créée le mardi 12 février – je suis tombée sur cette définition :
« Un mélange de déchets à base de muscles, d’os et de collagène. »
C’est le mot « collagène » qui m’ennuie le plus.
« Celui qui a haché le minerai a arnaqué »
Colette renvoie aussi vers le blog de Fabrice Nicolino, sur lequel est posté un document officiel [PDF] : la spécification technique n°B1-12-03 du 28 janvier 2003 applicable aux
viandes hachées et aux préparations de viandes hachées.
À sa lecture, cela se confirme. On peut donc mettre du « minerai » dans la viande hachée, « qui provient des muscles striés et des affranchis » (y compris les tissus graisseux).
Donc : après avoir découpé les morceaux « nobles » (entrecôte, faux-filet…) du bœuf, l’abattoir récupère les chutes non commercialisables, un bloc de 5 ou 10 kg vendu aux industriels pour la
fabrication des plats préparés : boulettes de viande, raviolis, lasagnes, hachis parmentier.
Cela représente 10% à 15% de la masse de l’animal.
« De l’âne et du mulet, personne ne s’en rendra compte »
L’affaire des lasagnes Findus devient plus compréhensible.
Il est impossible de confondre un steak de viande bovine et un steak de cheval, c’est facile de faire la différence même pour moi et les types de Comigel – fournisseur de Findus et de Picard – ne
s’y seraient pas laissé prendre. Même en petits morceaux, les deux matières ne se ressemblent pas : la viande bovine est plus rouge, plus grasse, elle n’a pas la même tenue.
Mais, à l’inverse, on peut prendre du minerai de porc ou de cheval (haché) pour un minerai de bœuf, très facilement. Constantin Sollogoub, ancien inspecteur des abattoirs à la retraite, m’explique
:
« Quand le minerai est haché il devient un magma prêt à entrer dans les plats préparés.
On ne peut plus savoir ce que c’est qu’avec des tests poussés. La mixture peut également contenir de l’âne et du mulet, personne ne s’en rendra compte. Celui qui a haché le minerai et qui a réalisé
le mélange entre le bœuf et le cheval est celui qui a arnaqué. Les autres se sont fait avoir. »
Il note qu’il est aussi possible de retrouver des parcelles de viande de porc dans des produits halal : c’est déjà arrivé et c’est bien plus grave.
« Même pas bon pour les chats »
Constantin
Sollogoub est un ancien vétérinaire libéral, sympa, enrôlé par l’État pour faire des inspections dans sa région (Nevers). Il nous dit qu’il connaît bien la Roumanie, pour y être allé
dans le cadre de son association « Coopération et Échanges vétérinaires » . Selon lui, « au passage », on y trouve surtout des vaches à lait et la viande qui en est issue est de mauvaise qualité.
Constantin Sollogoub se doutait qu’un scandale allait éclater un jour. À propos du minerai, il dit en se marrant :
« Ce sont des bouts de machin, de gras notamment. En fait, c’est catégoriquement de la
merde. Il y a 40 ans, cette matière allait à l’équarrissage pour être brûlée. Les industriels n’osaient même pas en faire de la bouffe pour chat.
Là-dessus, nos grandes maisons auréolées de luxe et de qualité, comme Picard, ont décidé
que c’était du gâchis… Avec les progrès de la chimie additionnelle, c’est devenu possible d’en faire quelque chose. C’est presque bon à manger, ça a bonne allure. Ces morceaux sont donc ramassés,
mis en bloc et congelés et ils se baladent à droite et à gauche. »
Une solution : redevenir parano
Constantin Sollogoub pense que la solution est de redevenir parano et de ne consommer que le steak haché que l’on voit passer dans la machine du boucher. Celui qui est dans les rayons
d’hypermarchés est moins sûr. Une dizaines d’acteurs ont probablement spéculé sur la matière, la qualité en a forcément pris un coup.
De son côté, Colette Roos conseille de se remettre à cuisiner avec des bons produits. Les lasagnes bolognaises, c’est 45 minutes de préparation. Et il faut avoir des feuilles de laurier sous la
main.
« Il fallait garder 40% de la viande avariée »
Témoignage d’un Intérimaire viande
Sous le papier Minerai de viande : « Avant on n’osait pas en faire de la bouffe pour
chat », un intérimaire a témoigné sous le pseudo de Kelval. Ses commentaires sous l’article ont été effacés, parce qu’il y donnait trop d’information et la société qu’il dénonçait pouvait être
reconnue. Mais son expérience est si intéressante que nous avons décidé de la publier nettoyée des infos permettant de reconnaître l’employeur.
J’ai travaillé dans une usine de « transformation de viande », et je suis dégoûté
définitivement de toutes les viandes hachées surgelées et des plats préparés.
C’était tellement « fou » pour des gens normaux que ma famille m’a conseillé de l’écrire
quelque part, ce que je n’ai jamais eu le courage de faire. Rue89 me donne l’occasion de témoigner, donc voici quelques souvenirs.
Dans ces usines, on transforme effectivement des bas morceaux tout à fait corrects en
merde. La recette était simple : on recevait des palettes de bas morceaux de marques de boucheries industrielles connues comme Bigard, qu’on décongelait dans des barattes (des sortes de
monstrueuses bétonnières de deux mètres de diamètre dans lesquelles on envoie de l’eau bouillante sous pression pour décongeler tout ça en vitesse), et on y ajoutait au cours de trois malaxages
successifs entre 30 et 40% du poids en graisse, plèvre, cartilages et autres collagènes.
On obtenait des quantités phénoménales de purée de viande qu’on mettait dans des bacs de
10 kg et qu’on tassait à coups de poings, puis qu’on renvoyait au surgélateur par palettes de 70 caisses. Oui, car on l’ignore souvent, mais on peut surgeler de la viande plusieurs fois de suite,
au contraire de la congélation classique.
Azote liquide pour agglomérer la viande
Il y avait aussi la ligne des « cubes de viande ». Vous êtes vous déjà demandé comment
ils font pour vous servir des cubes de viande si magnifiquement cubiques ?
Voilà la recette : en sortie de baratte, les ouvriers au nombre de deux ou trois
piochent à la main d’énormes brassées de viande sanguinolente, qui sont transférées dans une sorte d’énorme presse avec de nombreuses « étagères ».
On fait descendre les mâchoires qui compressent cette viande, et pour mieux
l’agglomérer, on fait circuler entre les plaques (mais, je suppose, pas en contact direct avec la viande, enfin je l’espère) de l’azote liquide.
Quand cette machine était en route ça puait tellement la chimie qu’on avait l’impression
d’être près des raffineries de l’Étang de Berre… L’azote étant un des composés de l’air, je suppose qu’il s’évaporait au sortir de la presse s’il y avait eu contact avec la viande. Mais quand
même…
Des petites quantités de viande dans la boucle depuis plusieurs mois
Après ce traitement, qui je suppose servait à « saisir » la viande pour l’agglomérer,
les plaques allaient au congélateur. Le lendemain, ces plaques étaient sorties et on les passait dans un énorme emporte-pièce hydraulique qui découpait les plaques congelées en cubes de 3 cm de
côté.
Ces cubes se déversaient alors sur un tapis roulant, et 2 ou 3 ouvriers dont je faisais
partie éliminaient tous les ratés, les formes bizarres, les morceaux trop petits ou trop gros. Ça demandait une grosse concentration, et la cadence était très soutenue. Les cubes passaient dans un
autre surgélateur à l’azote, avant de se déverser dans des sacs d’environ 20 kg.
Les « non conformes » étaient conservés, passaient dans la baratte suivante, puis sur
les plaques suivantes, etc. Virtuellement, il est tout à fait possible que des petites quantités de viande faisaient la boucle baratte – plaque – surgélation – cubes – non conforme – baratte –
plaque, etc. depuis des mois…
Vous pouvez vous en douter, les cadences étaient très dures à suivre, les heures
supplémentaires fréquentes et le travail éreintant. Les conditions « humaines » me semblaient particulièrement inhumaines, justement.
Cette viande a été mélangée à de la viande saine
Les conditions d’hygiène n’étaient guère meilleures. Je passe sur l’odeur de viande
écœurante. Le matin quand on arrivait, c’était propre ; mais très rapidement, vu nos activités, on pataugeait dans une boue grasse et sanglante qui recouvrait le sol.
Celle-ci était particulièrement glissante, donc très dangereuse. Pour ne pas avoir à la
nettoyer, et donc ralentir la cadence, on aspergeait régulièrement le sol de sel, ce qui augmentait la quantité de boue au fil des heures. Malgré ce sel, je suis tombé plusieurs fois.
Lorsqu’on mettait la viande destinée aux cubes de viande sur les plaques, on avait très
rapidement du sang sur tout le haut du corps et jusqu’aux épaules, malgré nos gants qui remontaient jusqu’aux coudes. Ambiance, ambiance…
Enfin, il y a eu cette fois, lors un arrivage manifestement avarié (la viande était
violette, verte, jaune, et puait, bien que surgelée), où le patron nous a imposé de trier et d’en garder impérativement 40%. Qu’on se débrouille ! Cette viande a été mélangée à de la viande saine.
Et hop ! Ni vu, ni connu, je t’embrouille.
Une main dans le hachoir
Nous manions des feuilles de boucher sans avoir été formés, nous étions en contact
permanent avec des hachoirs, des machines rotatives… Stress, fatigue, objets
dangereux ; avec ce cocktail, vous devinez sans doute où je veux en venir. J’ai assisté à plusieurs accidents du travail, plus ou moins graves.
Lors du dernier en date, et celui qui m’a décidé à partir, un de mes collègues (en CDI,
moi j’étais intérimaire) a passé la main dans un des monstrueux hachoirs à viande hachée. Il poussait régulièrement la viande à la main quand elle se bloquait. Bien sûr, à chaque remarque, il
objectait qu’il « faisait gaffe ».
Cette fois ci, c’était celle de trop. Doigts tout juste reliés à la main par des restes
de peau, tendons arrachés et j’en passe. Une catastrophe et des promesses de handicap à vie…
Alors qu’il montait dans le fourgon des pompiers, le patron est venu le voir, et lui a
dit « qu’il aurait dû lui dire s’il voulait des congés, c’était pas la peine de faire ça ». Quel connard ! J’en ai encore la gorge nouée à y repenser. C’était un des ouvriers les plus productifs de
l’usine, et il avait la trentaine, donc encore bien trente ans de boulot devant lui…
Je ne mange que la viande du boucher
Inutile d’en rajouter je crois, j’ai déjà fait bien assez long. Inutile aussi de vous
dire que je suis dégoûté à vie de la viande hachée industrielle. Le seul hachis que je mange, c’est celui que le boucher du coin de la rue sort de sa machine devant mes yeux. J’ai toujours évité
les plats préparés et préféré la bonne cuisine et le partage. Cette expérience n’a fait que me conforter dans mes opinions.
Je n’ai jamais su qui étaient les clients de « notre » viande, et sous quelle marque
elle était commercialisée. Les conditionnements sous lesquels elle sortait (10, 20 kg ou plus) me font penser qu’elle était destinée à l’industrie agro-alimentaire (plats préparés), et certainement
pas aux commerces ou supermarchés.
Je ne suis pas resté suffisamment longtemps pour en savoir plus non plus. Dès que j’ai
pu, j’ai sauté sur la première mission d’intérim qui me permettait de sortir de là, en me promettant de ne jamais y retourner.
Presse avariée (Nolwenn Le Blevennec, Rue89, 14 février 2013)